L’idéologie de l’infiltration : une arme de stigmatisation et d’exclusion en RDC
- Paul KABUDOGO RUGABA
- 1 oct. 2025
- 10 min de lecture
Dernière mise à jour : 2 oct. 2025
L’usage du terme « infiltré » dans le contexte congolais contemporain illustre un phénomène linguistique et politique de stigmatisation. Il est couramment mobilisé pour désigner les militaires tutsi congolais enrôlés au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), en particulier ceux issus des Banyamulenge du Sud-Kivu et des Tutsi du Nord-Kivu. Cette catégorisation procède d’une logique de négationnisme identitaire, visant à délégitimer leur citoyenneté et à effacer la reconnaissance historique de ces communautés comme composantes du tissu national congolais.
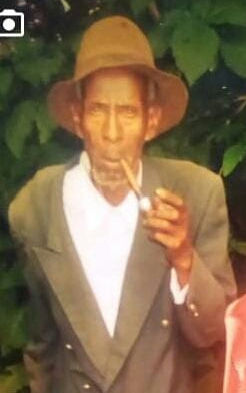
En qualifiant systématiquement ces officiers et soldats d’« infiltrés », le discours dominant les assimile à des agents étrangers – en l’occurrence rwandais – prétendument insérés dans l’armée congolaise afin de servir des intérêts extérieurs. Cette essentialisation repose sur une stratégie de déshumanisation et d’altérisation, déjà documentée dans les études sur la rhétorique des conflits (Staub, 1989 ; Mamdani, 2001). Elle constitue un mécanisme discursif par lequel l’ennemi est construit non pas comme un adversaire politique ou militaire légitime, mais comme un corps étranger, illégitime et menaçant. Ce processus s’apparente aux logiques de scapegoating (bouc émissaire) analysées dans la littérature sur les violences de masse et sert de matrice idéologique à des appels explicites ou implicites au nettoyage ethnique.
Il est particulièrement significatif que cette terminologie ait été reprise non seulement par des instigateurs de haine au niveau local, mais également par certains responsables politiques de haut rang, ce qui contribue à sa normalisation dans l’espace public. L’absence de condamnation claire de cet usage, notamment de la part des acteurs internationaux tels que la Mission des Nations unies (MONUSCO) ou les organisations non gouvernementales internationales et locales, accentue le caractère problématique de cette banalisation. En tolérant ou en ignorant ce vocabulaire, ces acteurs laissent se développer un cadre discursif qui justifie les violences répétées à l’encontre des communautés concernées, sous le prétexte fallacieux qu’elles constitueraient un refuge pour des « infiltrés ».
Dans une perspective de droit international, cette rhétorique peut être rapprochée de ce que le Rapporteur spécial des Nations unies sur la prévention du génocide désigne comme des signaux précoces de violence de masse, notamment à travers l’emploi d’un langage de déshumanisation et de suspicion collective (ONU, 2015). Le cas congolais s’inscrit ainsi dans une dynamique où les mots précèdent et légitiment les actes, rappelant que le vocabulaire n’est pas neutre, mais qu’il constitue une arme idéologique dans la fabrique de l’ennemi intérieur.
Mais d’où vient donc cette histoire d’“infiltrés” ?
La République démocratique du Congo, dans ses frontières actuelles, est une création de l’entreprise coloniale belge. Ces frontières, fixées au tournant du XXe siècle dans le cadre du « partage de l’Afrique », sont devenues intangibles et quasi sacrées après l’indépendance, au point d’être perçues comme l’un des fondements de l’identité nationale congolaise. Cette sacralisation des limites héritées du colonialisme s’inscrit dans la logique de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), qui, dès 1964, a consacré le principe de l’intangibilité des frontières afin de prévenir les conflits territoriaux (Young, 1994). Pour de nombreux Congolais, la fierté réside dans l’immensité et la richesse du territoire. Pourtant, ce même pouvoir colonial, aujourd’hui célébré comme fondateur, fut à l’origine de déplacements massifs de populations, organisés pour mettre en valeur les terres agricoles et exploiter les mines (Nzongola-Ntalaja, 2002).
Un siècle plus tard, l’histoire de ces migrations forcées demeure occultée, tandis qu’une partie de la population continue d’être désignée comme « infiltrée ». Cette étiquette, loin d’être anecdotique, s’est enracinée à travers des décennies de propagande et de politiques successives, adaptées à chaque régime. Certains de ceux qui avaient été installés dans les régions minières furent contraints de repartir vers le Rwanda après 1994, dans un contexte de menaces existentielles, tandis que d’autres, établis durablement dans des territoires comme le Masisi au Nord-Kivu, sont encore victimes d’une stigmatisation persistante.
Cette situation met en évidence une contradiction majeure : pourquoi ériger en principe intangible les frontières coloniales héritées de la Belgique, tout en refusant de reconnaître les réinstallations et mouvements de population organisés par cette même puissance coloniale ? Une telle posture ne procède pas d’un principe juridique ou historique cohérent, mais révèle une instrumentalisation sélective de l’héritage colonial, qui constitue une injustice flagrante.
Plus inquiétant encore, l’accusation d’« infiltration » s’est élargie à des groupes qui n’ont jamais été concernés par ces réinstallations, notamment les Banyamulenge du Sud-Kivu et les habitants de Rutshuru. Ceux-ci sont pourtant nés et établis sur leurs propres terres, intégrées par la suite dans le Congo indépendant comme tous les autres groupes. Les désigner comme étrangers sur la seule base de leur langue ou de leur culture revient à appliquer une logique d’exclusion ethnique qui nie le principe même de citoyenneté (Mamdani, 2001).
Cette stratégie discursive, aujourd’hui exploitée par le pouvoir de Kinshasa, vise à convaincre l’opinion nationale et internationale de l’existence d’une infiltration étrangère. Il s’agit en réalité d’une construction idéologique qui transforme certains citoyens en « étrangers intérieurs » (Mbembe, 2000), justifiant ainsi leur marginalisation et, dans certains cas, leur élimination. À l’instar d’autres contextes africains marqués par l’instrumentalisation des frontières héritées et par l’essentialisation de l’ethnicité (Lemarchand, 2009), le cas congolais illustre les effets durables de l’héritage colonial lorsqu’il est manipulé dans des logiques de pouvoir et d’exclusion.
L’étiquette d’« infiltré » attribuée aux Tutsi congolais — qu’il s’agisse des Banyamulenge du Sud-Kivu ou des Tutsi du Nord-Kivu — ne relève pas d’un simple usage lexical. Elle s’impose comme une arme idéologique et un instrument de stigmatisation visant à nier leur statut de citoyens à part entière de la République démocratique du Congo. Par ce vocabulaire, se déploie une stratégie politique qui entretient un doute permanent quant à leur légitimité nationale, justifiant ainsi leur exclusion, leur persécution et, dans de nombreux cas, leur élimination physique.
Cette rhétorique est d’autant plus révélatrice qu’elle ne s’applique pas aux réfugiés rwandais de 1994, dont plusieurs milliers d’anciens combattants — notamment issus des Forces armées rwandaises (ex-FAR) et des milices Interahamwe — furent intégrés dans l’armée congolaise en toute connaissance de cause par les autorités. Le fait que seuls les Tutsi congolais soient ciblés par l’étiquette d’« infiltré » démontre que cette catégorisation n’est pas la conséquence d’un malentendu historique ou juridique sur la nationalité, mais bien une construction politique reposant sur des critères ethniques et raciaux.
La prétendue « infiltration » doit donc être comprise comme l’expression d’une idéologie génocidaire dans sa forme la plus explicite, une idéologie que le discours politique et militaire congolais a progressivement importée, intégrée et institutionnalisée. En ce sens, elle ne constitue pas un simple abus de langage, mais un cadre discursif systématique destiné à transformer des citoyens en « étrangers intérieurs » et, partant, en cibles légitimes de violences.
Cette instrumentalisation du langage n’est pas sans rappeler d’autres contextes génocidaires documentés par la recherche. Au Rwanda, par exemple, les Tutsi furent systématiquement qualifiés d’Inyenzi (« cafards »), d'Inzoka ("serpent") une dénomination visant à déshumaniser et à préparer psychologiquement leur extermination (Des Forges, 1999 ; Mamdani, 2001). Dans les Balkans, des expressions telles que ustaše ou balija furent utilisées pour essentialiser l’ennemi et alimenter des campagnes de nettoyage ethnique (Oberschall, 2000). De manière générale, Gregory Stanton (1996) souligne que la stigmatisation verbale et la catégorisation raciale ou ethnique constituent l’une des étapes préliminaires et indispensables à la dynamique du génocide.
Ainsi, l’usage du terme « infiltré » en RDC s’inscrit dans une logique comparable : il vise à délégitimer une communauté en la présentant comme étrangère, dangereuse et illégitime, ouvrant la voie à son exclusion et à sa destruction. Ce processus rappelle que les mots précèdent les actes, et qu’ils fonctionnent comme des signaux précoces de violences de masse, tels que définis par le Rapporteur spécial des Nations unies sur la prévention du génocide (ONU, 2015).
L’injustice est patente. Les communautés tutsi congolaises, qu’il s’agisse des Banyamulenge du Sud-Kivu ou des Bajomba et Bagogwe du Nord-Kivu, vivent sur ce territoire depuis des générations, avant la fixation des frontières actuelles par la colonisation belge. Or, c’est précisément ce pouvoir colonial qui, tout en traçant les limites de l’État congolais, a également déplacé et installé des populations afin de valoriser les terres et exploiter les mines. Cette mémoire historique révèle une contradiction fondamentale : les autorités congolaises revendiquent avec fierté l’intangibilité des frontières héritées de Bruxelles, mais refusent de reconnaître les mouvements migratoires organisés par cette même puissance coloniale. On accepte la carte territoriale issue du partage colonial, mais on nie les vies humaines qui en sont aussi la conséquence. Une telle incohérence s’apparente à une injustice historique institutionnalisée.
L’histoire des réfugiés dans la région des Grands Lacs montre pourtant que l’accueil et l’intégration de populations déplacées n’ont rien d’exceptionnel. Dès 1959, la RDC a ouvert ses portes à des réfugiés rwandais fuyant les violences et bouleversements politiques de leur pays. Inversement, le Rwanda a accueilli depuis plus de trois décennies des dizaines de milliers de Congolais contraints à l’exil. Cet échange d’hospitalité illustre un phénomène universel : de nombreux États, partout dans le monde, accueillent des réfugiés sans pour autant stigmatiser certaines catégories de leur propre population en les qualifiant « d’infiltrés ».
Le cas congolais présente donc une singularité inquiétante. Loin de distinguer entre réfugiés — déplacés par les crises — et citoyens congolais de longue date, un amalgame volontaire a été entretenu par les élites politiques et militaires, visant notamment les Banyamulenge. Or, cette « infiltration » est purement imaginaire. Si infiltration il y avait, elle relèverait d’une défaillance de l’État lui-même, puisqu’il appartient aux institutions publiques de gérer les flux migratoires, de délivrer des documents d’identité et d’attribuer la nationalité. Accuser une communauté entière « d’infiltration » revient donc à transférer sur les victimes la responsabilité des manquements étatiques, dans un renversement cynique qui traduit une logique discriminatoire.
Cette construction idéologique frappe de plein fouet les Banyamulenge et d’autres Tutsi congolais. Ces communautés, profondément enracinées dans leurs traditions, clans et territoires, n’ont jamais renié leur identité ni leur langue. De la même manière, les Rwandais sont attachés à leur appartenance nationale et culturelle. Assimiler ces citoyens congolais à des étrangers constitue donc une falsification historique et une entreprise de déshumanisation, destinée à les présenter comme des « corps étrangers » à éliminer.
Ce qui accentue la gravité de cette situation, c’est le silence persistant de la communauté internationale, en particulier celui des Nations unies. Une organisation dont le mandat officiel consiste à préserver la paix, à protéger les minorités et à prévenir les crimes de masse ne saurait ignorer la dangerosité d’un vocabulaire de stigmatisation. L’histoire récente en fournit un exemple tragique : au Rwanda, avant le génocide de 1994, les Tutsi furent désignés à travers un lexique déshumanisant — « cafards » (Inyenzi), « serpents » (Inzoka), « envahisseurs » — qui servit à légitimer et préparer leur extermination.
En République démocratique du Congo, l’usage récurrent des termes tels que « infiltrés », « vermine » ou encore « Rwandais » reproduit une logique similaire. Ce langage performatif fonctionne comme un instrument d’exclusion et un préalable à la violence systématique. Ses effets concrets se traduisent par une marginalisation multiple : exclusion de certaines communautés des espaces publics et politiques, refus d’accorder des funérailles officielles à des officiers et soldats morts sous le drapeau national, violences sexuelles systématiques, embargo économique imposé à l’ensemble d’une communauté, destruction des moyens de subsistance, déplacements forcés de populations, arrestations arbitraires, tortures jusqu’à la mort, pillage de bétail, incendie et destruction de villages entiers, lynchages, immolations, voire pratiques de cannibalisme et massacres de masse.
Or, malgré plus d’un quart de siècle de présence, la Mission des Nations unies en RDC (MONUC, puis MONUSCO) a choisi de détourner le regard face à cette rhétorique et à ses conséquences, comme si elle était dénuée d’incidence.
Cette indifférence est lourde de sens. Elle traduit soit une incompréhension volontaire du contexte, soit une complicité tacite avec les autorités congolaises. Dénoncer cette manipulation reviendrait en effet à reconnaître que l’État congolais instrumentalise un mensonge pour justifier des politiques discriminatoires, voire criminelles. L’ONU préfère alors maintenir une neutralité de façade, au prix du sacrifice d’une communauté entière. En cela, elle participe au processus décrit par Gregory Stanton (1996) dans son modèle des étapes du génocide : l’usage de mots de stigmatisation constitue un signal précoce, mais si ces signaux ne sont pas dénoncés, ils se transforment en violence effective.
Le mensonge de « l’infiltration » est pourtant aisément démontable. Une enquête historique sérieuse sur la colonisation et sur les réalités démographiques du Congo suffirait à en montrer le caractère fallacieux. Mais en s’abstenant de cette démarche, les acteurs internationaux cautionnent implicitement la propagande locale. Ce silence confère au mensonge le statut de vérité « officielle », sur lequel reposent les politiques d’exclusion et les violences récurrentes.
Ainsi, l’injustice dont souffrent les Banyamulenge et les autres Tutsi congolais n’est pas seulement le produit des pratiques de Kinshasa : elle est aggravée par la passivité des garants internationaux de la paix. En refusant de dénoncer un discours mensonger et dangereux, l’ONU se rend complice par omission. La question devient dès lors inévitable : combien de temps la communauté internationale continuera-t-elle à détourner le regard, alors même que les mots employés en RDC reproduisent les mêmes schémas que ceux qui ont conduit aux drames déjà vécus dans la région ?
En définitive, la stigmatisation des Banyamulenge et d’autres Tutsi congolais illustre l’échec non seulement de l’État congolais à protéger tous ses citoyens, mais également celui des institutions internationales à reconnaître et à prévenir les signes précurseurs de crimes de masse. Loin d’être une simple querelle sémantique, l’accusation « d’infiltration » constitue un symptôme d’idéologies génocidaires. Le mutisme de la communauté internationale face à cette dérive révèle une complicité silencieuse, qui interroge la légitimité même du système international de protection des peuples.
Le 1er octobre 2025
Paul Kabudogo Rugaba
Références mobilisables :
Achille Mbembe, De la postcolonie (2000)
Mahmood Mamdani, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda (2001)
René Lemarchand, The Dynamics of Violence in Central Africa (2009)
Georges Nzongola-Ntalaja, The Congo: From Leopold to Kabila (2002)
Des Forges, Alison. Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. New York: Human Rights Watch, 1999.
Lemarchand, René. The Dynamics of Violence in Central Africa. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009.
Mamdani, Mahmood. Define and Rule: Native as Political Identity. Cambridge: Harvard University Press, 2012.
Mbembe, Achille. De la postcolonie. Paris: Karthala, 2000.
Nzongola-Ntalaja, Georges. The Congo: From Leopold to Kabila. London: Zed Books, 2002.
Stanton, Gregory H. The 8 Stages of Genocide. Washington DC: Genocide Watch, 1996.
Stearns, Jason. Dancing in the Glory of Monsters: The Collapse of the Congo and the Great War of Africa. New York: PublicAffairs, 2011.
Young, Crawford. The African Colonial State in Comparative Perspective. New Haven: Yale University Press, 1994.




Commentaires